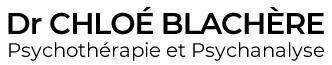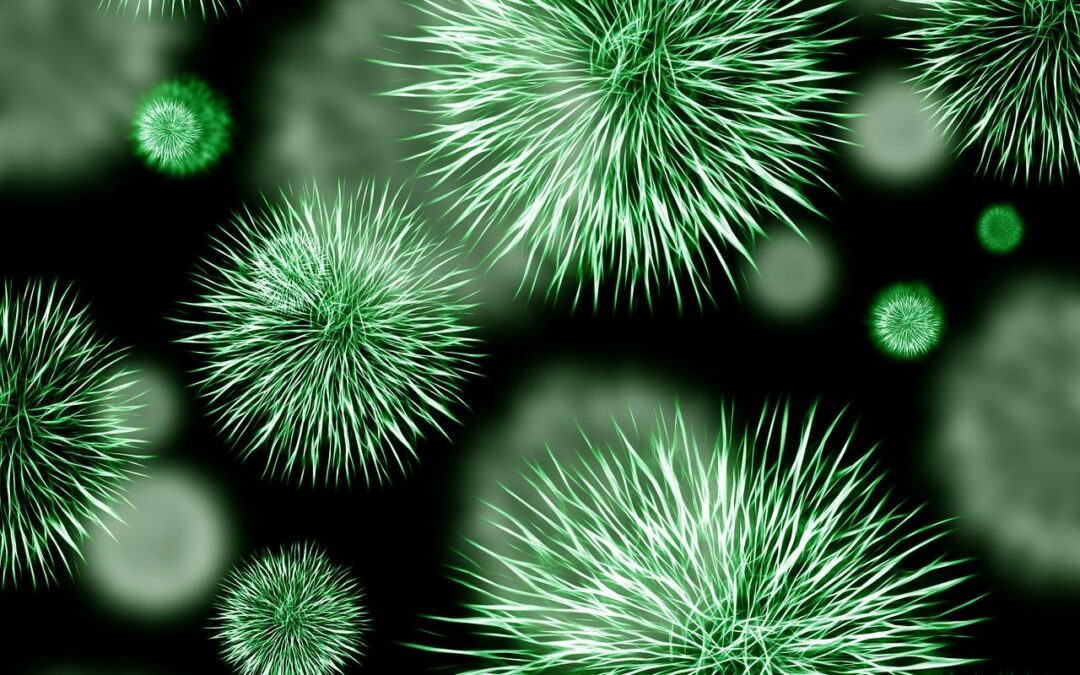La résistance correspond aux différentes stratégies, conscientes et inconscientes, qui ralentissent, voire mettent en échec, l’avancée du travail de psychothérapie ou de psychanalyse dans lequel un être s’est pourtant lui-même engagé. Les formes que la résistance peut prendre sont variées et visent le plus souvent notamment à masquer le fait même qu’il s’agit de résistance.
Dès 1895, Sigmund Freud en fait état dans ses Etudes sur l’hystérie (1), lorsqu’il observe que certains souvenirs se refusent à la remémoration.
C’est ensuite en 1925, à l’occasion de son ouvrage Inhibition, symptôme et angoisse (2), que Freud classifie cinq formes de résistances :
- Le refoulement,
- La résistance au transfert,
- Le bénéfice secondaire de la maladie,
- La résistance à l’inconscient,
- La résistance du Surmoi.
En référence aux instances psychiques, Freud observe que les trois premières correspondent aux résistances du Moi, la quatrième à une résistance du Ça et la dernière, comme son nom l’indique, à une résistance du Surmoi, qui dérive du besoin de punition et d’un sentiment de culpabilité inconscient. Il s’agit de la résistance la plus importante dans la mesure où elle nourrit la peur de la guérison. En ce sens, cette résistance peut également être à l’origine d’un certain nombre d’échecs thérapeutiques.
Parmi ceux qui n’abandonnent pas leur cure, il en est qui témoignent du sentiment qu’ils associent à cette résistance et qui correspond au fait qu’ils pensent qu’ils ne méritent pas de réussir. Ainsi, c’est en dépit de la lassitude éprouvée que se dessinent les répétitions. Les mêmes schémas sont reproduits, de manière à perpétuer l’auto-sabotage.
La cure psychanalytique consiste à dévoiler progressivement les éléments inconscients qui se trouvent au fondement du sentiment de culpabilité et du besoin de punition jusqu’à ce que le traitement puisse faire ses effets et permettre au psychanalysant de s’engager à construire sa subjectivité (3).
Ainsi, le psychanalysant utilise ses résistances – conscientes et inconscientes – pour empêcher sa cure d’avancer et donc pour se freiner lui-même. Pour son Moi, tout ce qui peut venir de l’extérieur devient fautif tant que cela peut lui éviter de regarder sa part de responsabilité. Dans ce tout, il est à entendre par exemple un patron, un compagnon ou une compagne, des collègues, des amis, le clinicien ou encore la société. La résistance peut alors prendre celle de se plaindre de l’autre. Elle voile toujours la haine et, avec elle, une peur de réussir, une peur de s’engager, une peur de prendre des décisions. Et de la même manière, une infinité de formes de résistances peuvent éclore à mesure que le travail avance et s’inviter dans le champ clinique : ne pas prendre de quoi régler sa séance, arriver en retard, ne pas respecter la règle d’association libre des pensées, etc.
Supporter d’aller bien, ne pas faire semblant, s’engager avec son travail, aimer, il s’agit bien là d’une construction dont la temporalité va être propre à chacun. Dans tous les cas, il s’agit d’un travail qui demande à ce que les différentes résistances qui se présentent et viennent l’entraver soient travaillées une à une. Ce travail ne peut se faire qu’avec un désir décidé d’occuper une position autre que celle qui a conduit à commencer une psychothérapie ou une psychanalyse.
(1) Freud, S. (1895). « Etudes sur l’hystérie », in Œuvres Complètes, Vol. II, Paris, PUF, 2009, pp. 9-332.
(2) Freud, S. (1925). « Inhibition, symptôme et angoisse », in Œuvres Complètes, Vol. XVII, Paris, PUF, 1992, pp. 203-86.
(3) Amorim (de), A. (2025). La responsabilité, https://www.fernandodeamorim.com/la-responsabilite/
Docteur Chloé Blachère
Psychothérapie et psychanalyse à Paris 18è